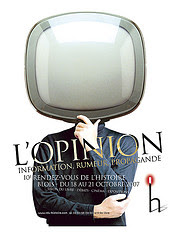"Créee en 1957, par Arthur Laurents (parole) et Leonard Bernstein (Musique) cette comédie musicale qui transpose Roméo et Juliette dans les quartiers pauvres de New York connaît un succès considérable sur les planches de Broadway puis en tournée à travers les États-Unis. En 1961, elle est adaptée au cinéma par le réalisateur Robert Wise, rafle une flopée d’oscar et reçoit un accueil enthousiaste dans le monde entier."
"Créee en 1957, par Arthur Laurents (parole) et Leonard Bernstein (Musique) cette comédie musicale qui transpose Roméo et Juliette dans les quartiers pauvres de New York connaît un succès considérable sur les planches de Broadway puis en tournée à travers les États-Unis. En 1961, elle est adaptée au cinéma par le réalisateur Robert Wise, rafle une flopée d’oscar et reçoit un accueil enthousiaste dans le monde entier."samedi 27 septembre 2008
Forces et faiblesses du modèle américain : "America" (West Side Story)
 "Créee en 1957, par Arthur Laurents (parole) et Leonard Bernstein (Musique) cette comédie musicale qui transpose Roméo et Juliette dans les quartiers pauvres de New York connaît un succès considérable sur les planches de Broadway puis en tournée à travers les États-Unis. En 1961, elle est adaptée au cinéma par le réalisateur Robert Wise, rafle une flopée d’oscar et reçoit un accueil enthousiaste dans le monde entier."
"Créee en 1957, par Arthur Laurents (parole) et Leonard Bernstein (Musique) cette comédie musicale qui transpose Roméo et Juliette dans les quartiers pauvres de New York connaît un succès considérable sur les planches de Broadway puis en tournée à travers les États-Unis. En 1961, elle est adaptée au cinéma par le réalisateur Robert Wise, rafle une flopée d’oscar et reçoit un accueil enthousiaste dans le monde entier."lundi 22 septembre 2008
Entre les murs, le livre d'abord en attendant le film

C'est cette semaine que le film de Laurent Cantet sort sur les écrans... Je rappelle qu'il a obtenu la palme d'or à Cannes en mai dernier et que l'auteur François Bégaudeau incarne le rôle du professeur....


Bégaudeau, Bégaudeau....ah, si je prends le livre en main et que je regarde la biographie succincte, je lis qu'il a publié moins d'une demi-douzaine de livres entre 2003 et 2006 dont le dernier est Entre les murs. J'apprends sur Wikipedia qu'il est l'auteur en 2008 de l'antimanuel de littérature (collection assez formidable à laquelle Bernard Maris et Michel Onffray ont déjà participé). Je sais qu'il est jeune (né en 1971) et assez beau garçon (à vous de juger) et qu'il a d'abord été professeur de lettres dans le secondaire avant de devenir écrivain à plein temps. Il a été également membre d'un groupe de rock-punk, les Zabriskie Point.
Depuis la sortie et le succès de son livre Entre les murs sa vie professionnelle semble transformée...chroniqueur littéraire sur Canal +, dans des magazines, il publie beaucoup ....son tout dernier (Une chic fille) est consacré à la journaliste prise en otage en Irak, Florence Aubenas.
Revenons à son livre qui lui a permis de sortir de l'anonymat (le prix Télérama et photo en Une du même magazine), Entre les murs est un drôle de livre. Le style est assez simple, Bégaudeau nous invite dans le quotidien d'un enseignant de Lettres dans un collège de banlieue parisienne. Ce livre ne s'adresse pas exclusivement aux enseignants même si du coup, il est facile pour ces derniers de s'identifier.... C'est assez bien réussi....ces relations de travail entre enseignants : les phrases et les mots raisonnent bien, on sent le vécu. Cela ne veut pas pour autant dire qu'il s'agit d'un bon livre.
Lire la suite ici
JC Diedrich
mercredi 17 septembre 2008
Histoire et géographie de la Mafia

mardi 16 septembre 2008
Les Temps modernes de Chaplin.

Lire la suite de l'article
mardi 9 septembre 2008
"Bamako" ou la Banque mondiale en procès
 Arte diffuse samedi soir à 22h30 une version remontée du film d'Abderrahmane Sissako, Bamako. Le titre est légèrement modifié puisque le téléfilm s'intitule Bamako, la cour.
Arte diffuse samedi soir à 22h30 une version remontée du film d'Abderrahmane Sissako, Bamako. Le titre est légèrement modifié puisque le téléfilm s'intitule Bamako, la cour.Si vous avez envie d'être surpris par un film original tout en éveillant votre esprit critique sur la mondialisation, alors regardez ou enregistrez ce film. Il aborde en effet la plupart des questions que suscitent la mondialisation et que nous abordons en cours de terminale.

Voici le synopsis :
Retrouvez le reste de la sélection télé dans le menu à droite.
dimanche 20 juillet 2008
Soirée black is beautiful sur Arte.
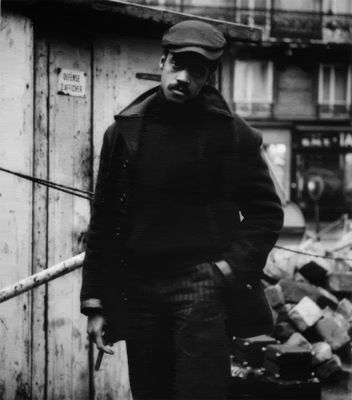 Melvin Van Peebles, le réalisateur de Sweet sweetbacks badasssss song.
Melvin Van Peebles, le réalisateur de Sweet sweetbacks badasssss song.Arte propose mardi 22 juillet une soirée "black is beautiful", soit le mouvement de fierté noire (black pride) qui incite les Afro-américains à assumer fièrement leur identité spécifique, leurs racines culturelles et leur couleur de peau à partir de la fin des années 1960 (une fois les premières victoires pour l'obtention des droits civiques acquises).
Au cinéma, les films de la blaxploitation s'inscrivent dans ce mouvement.
* La Blaxploitation.
A parti de 1971, la naissance de la Blaxploitation (contraction des mots « black » et « exploitation ») constitue la première offensive cinématographique noire contre la représentation traditionnelle et dévalorisante des Noirs à l’écran. Des films plus en phase en tout cas avec l'existence des Afro-américains, notamment dans les ghettos. Pour la première fois, ils deviennent acteurs de leur destin à l'écran, plus seulement des personnages passifs.

Un genre où les héros évoluent dans un univers fait de violence, de trafics, de justice privée et de sexe.
Un genre spécifiquement destiné au public Afro-américain et où la musique noire va tenir un rôle primordial et complémentaire aux films (exemple avec le célèbre thème de Shaft composé par Isaac Hayes, ou Superfly de Curtis Mayfield , la B.O. de "Black Caesar" par James Brown.
La Blaxploitation restera au sommet pendant un peu plus de quatre ans. Ensuite, les réalisateurs n’arrivent plus à renouveler le genre et finissent par le faire sombrer dans le ridicule.
La Blaxploitation aura en tout cas permis aux Afro-américains de se faire une place dans le cinéma et dans la société américaine par la même occasion.
Arte propose mardi soir deux classiques de la blaxploitation:
- 21h00 Shaft
John Shaft est le détective le plus cool de Harlem. Il ne roule pas en Aston Martin, ne possède pas de stylo explosif et ne finit pas ses aventures sous les palmiers d'une île tropicale. Rien de tout ça ne l'empêche d'être un véritable tombeur qui résout ses enquêtes sans sourciller face au danger. Sa mission: retrouver la fille de Bumpy Jonas, baron de la drogue sur lequel la mafia blanche fait pression. Il va réussir en s'associant à un groupe de militants noirs qui a le plus grand besoin de l'argent de Bumpy pour... lutter contre lui.
(Film de Gordon Parks, 96’ 1971)
Avec Charles Cioffi, Moses Gunn, Richard Roundtree, Christopher St John, Gwenn Mitchell
Enfin, à 00h40 Sweet sweetback baadassss song de Melvin Van Peebles (voir ci-dessus).
Cette black pride passe aussi par la musique, aussi la chaîne franco-allemande diffuse à 22h35, un documentaire de Philippe Manoeuvre consacré à James Brown, suivi à 23h 40 d'un concert du godfather of soul à Monterey, en 1979.
En effet en 1968, lorsque Brown adopte son fameux brushing au profit d'une coiffure afro, l'événement donne lieu a de nombreux commentaires dans la presse. Ainsi, le magasine Soul lance:"Depuis des années, le King était un esclave. Esclave de qui, de quoi? James Brown devait arborer cette coiffure qui lui demandait de douloureuses heures de préparation, depuis des temps immémoriaux. Jusqu'au mois dernier. A présent, le King arbore une coiffure afro. Tout le monde, y compris les Blacks Panthers et le SNCC (l'organisation étudiante de plus en plus radicale), pense que c'est une bonne chose. "
De fait, il n'aura de cesse de clamer haut et fort et d'assumer avec fierté son identité d'afro-américain, comme le prouve avec force son titre "Say it loud, I'm black and i'm proud".
Liens:
- La représentation des Noirs dans le cinéma américain, des origines aux années 1970.
- Soirée Black is beautiful sur Arte.
- Deux titres célébrant la fierté retrouvée des Noirs américains sur L'Histgeobox:
The temptations: "Message from a black man".
James Brown:"Say it loud!"
Découvrez James Brown!
jeudi 17 juillet 2008
Valse avec Bachir d'Ari Folman : Liban, 1982
 J'ai vu pour vous Valse avec Bachir d'Ari Folman. Un film original dans la forme et qui m'a beaucoup plu. Il donne envie de comprendre ce qui s'est passé. Voici pour vous quelques éléments de réponse :
J'ai vu pour vous Valse avec Bachir d'Ari Folman. Un film original dans la forme et qui m'a beaucoup plu. Il donne envie de comprendre ce qui s'est passé. Voici pour vous quelques éléments de réponse :lundi 30 juin 2008
Aux sources du Jazz européen ce soir sur Arte
 Arte diffuse ce soir un documentaire qui retrace la manière dont le Jazz a gagné l'Europe de l'après-guerre :
Arte diffuse ce soir un documentaire qui retrace la manière dont le Jazz a gagné l'Europe de l'après-guerre :"L'histoire du jazz européen commence après la Seconde Guerre mondiale dans les caveaux de Saint-Germain-des-Prés, quartier parisien où se retrouvent des artistes et des intellectuels incarnant l'esprit de l'époque. Les jazzmen afro-américains, marginaux dans leur pays à l'image de la bohème des cafés parisiens, y sont accueillis à bras ouverts. Bien avant l'avènement du rock 'n' roll, le jazz est en effet la musique dans le vent. Il devient rapidement le signe de reconnaissance d'une avant-garde assoiffée de liberté."
Découvrez Miles Davis!
Je vous reparlerai prochainement du rôle du Jazz durant la guerre froide.
Retrouvez le reste de la sélection télé de la semaine à droite. A voir notamment un documentaire sur l'industrie nigériane du cinéma, le fameux Nollywood, troisième producteur mondial de films...
vendredi 30 mai 2008
De l'autre côté

Lire la suite
dimanche 4 mai 2008
Deux films : Just A Kiss et La Ligne Rouge
 La semaine télévisuelle est très riche. De nombreux documentaires sont consacrés à des thèmes à votre programme. Je retiens deux films que j'ai personnellement beaucoup aimé :
La semaine télévisuelle est très riche. De nombreux documentaires sont consacrés à des thèmes à votre programme. Je retiens deux films que j'ai personnellement beaucoup aimé :- Just a kiss (Arte, lundi à 21h) Un film magnifique de Ken Loach sur la difficulté d'être soi et d'aimer malgré les préjugés. C'est la chronique des amours impossibles entre une catholique irlandaise et un musulman d'origine pakistanaise à Glasgow.
 - La ligne rouge (F3, jeudi à 20h55) Un film magnifique sur et contre la guerre. A Guadalcanal, en 1942, Japonais et Américains s'affrontent dans un combat sans merci. Terrence Mallick donne la parole à des soldats incarnés par des acteurs remarquables. A voir absolument !
- La ligne rouge (F3, jeudi à 20h55) Un film magnifique sur et contre la guerre. A Guadalcanal, en 1942, Japonais et Américains s'affrontent dans un combat sans merci. Terrence Mallick donne la parole à des soldats incarnés par des acteurs remarquables. A voir absolument !jeudi 1 mai 2008
Deux films pour comprendre le conflit israélo-palestinien

J'ai vu récemment deux films réalisés par des cinéastes israéliens qui nous permettent cette plongée.
mardi 29 avril 2008
Carnets de Voyage sur Arte

jeudi 24 avril 2008
La Zona : ségrégation urbaine et violence à Mexico
 A l'heure où les inégalités se constatent à toutes les échelles, les mégapoles des du Sud voient leur espace se fragmenter. Cette fragmentation a pour logique, sur le modèle américain, de séparer riches et pauvres, blancs et noirs (ici des populations indigènes), éduqués et analphabètes, "gens de bien" et "gens de peu",.... Les Gated Communities, ces communautés fermées apparues dès les années 1930 aux États-Unis, essaiment dans ce pays et le monde entier depuis les années 1960 . Au Mexique, La Zona est l'une d'elles.
A l'heure où les inégalités se constatent à toutes les échelles, les mégapoles des du Sud voient leur espace se fragmenter. Cette fragmentation a pour logique, sur le modèle américain, de séparer riches et pauvres, blancs et noirs (ici des populations indigènes), éduqués et analphabètes, "gens de bien" et "gens de peu",.... Les Gated Communities, ces communautés fermées apparues dès les années 1930 aux États-Unis, essaiment dans ce pays et le monde entier depuis les années 1960 . Au Mexique, La Zona est l'une d'elles.mercredi 16 avril 2008
Tudor or not Tudor ?
 Cela ressemble à du Shakespeare. Pouvoir, ambition, amour, sang... Un film et une série télévisée sont consacrés aux Tudor en général et à Henry VIII, l'homme aux six femmes en particulier.
Cela ressemble à du Shakespeare. Pouvoir, ambition, amour, sang... Un film et une série télévisée sont consacrés aux Tudor en général et à Henry VIII, l'homme aux six femmes en particulier.mardi 18 mars 2008
Mai 68 s’invite à Cannes
Aux Oscars, on récompense « Dans la chaleur de la nuit » de Norman Jewison, où un flic noir incarné par Sidney Poitier, (l’une des premières star afro-américaine) enquête sur un meurtre dans une petite ville raciste du Mississipi. 6 jours avant la cérémonie, Martin Luther King était assassiné. Nous en reparlerons...
bloquant les projections du festival.
En France, les événements de 68 vont rattraper le petit monde du cinéma et perturber cette belle institution bien huilée qu'est le festival de Cannes. Pour une fois aux avants-postes de la contestation sociale, le petit monde du 7ème art entend bien devenir le porte parole et le fer de lance de la révolution en marche. Si le résultat immédiat ne dépassera pas la simple annulation de la remise des prix du festival, les conséquences à long terme seront l'émergence d'une nouvelle génération de cinéastes et de producteurs qui vont dans la décennie qui suit prendre en main les rênes du cinéma français.
Lire la suite...
jeudi 13 mars 2008
"A bientôt j’espère" raconte la grève de Rhodiaceta en 1967

Ce petit film militant a été tourné en décembre 1967. Il évoque une grève qui a marqué les esprits à Besançon et en France. Celle-ci se caractérisa par une longue occupation d’usine, près d’un an avant les grèves de mai 68. Le film tourné après la grève par Chris Marker est diffusé en février 1968 à la télévision française. Il est intitulé « A bientôt j’espère », promesse lancée par un gréviste aux patrons, interprété a posteriori comme un défi prémonitoire.
Le film
Cliquez ici pour lire la suite...
jeudi 6 mars 2008
Survivre dans "l'enfer du Nord"
lundi 18 février 2008
JUNO, une image des Etats-Unis différente

Voici la bande annonce

Juno réussit finalement à trouver une famille d'accueil. Un jeune couple aisé, vivant dans une Gated community reçoit la famille un peu prolo de Juno afin de signer un contrat d'adoption. La scène est drôle, Juno est spontanée parfois un peu grossière et choque la mère adoptive. Sans trop forcer le trait sur le fossé existant entre les classes sociales, le réalisateur nous montre une Amérique plurielle.
Heureusement, la fin ressemble à un happy end, doux amer. Elle abandonne son bébé et reprend sa vie d'ado atypique. Juno tombe amoureuse de l'adolescent un peu introverti, coureur de fond, avec qui elle avait eu l'enfant non désiré.
Tout fini par un duo de guitare, d'un joli folk...d'Andrew Bird.
Jean-Christophe Diedrich
dimanche 17 février 2008
Deux films pour comprendre la face sombre du "nouvel ordre mondial"
 Lord of war
Lord of warOriginaire d'Ukraine, Yuri Orlov (l'excellent Nicolas Cage) a grandi à Brooklyn dans ce qu'on appelle la "Little Odessa". Peu désireux de passer sa vie dans le restaurant de ses parents, il se lance dans la vente d'armes et devient un marchand de haut vol.
mardi 12 février 2008
Rambo, symbole de l'Amérique triomphante ou désenchantée ?

Personnage de guerrier invincible, Rambo incarné par Sylvester Stallone va devenir le symbole de l’Amérique triomphante des années 80. Avec la sortie de John Rambo, Sylvester Stallone ressuscite ce personnage pour le montrer vieillissant mais encore dévastateur. Si le boxeur Rocky Balboa, l’autre personnage fétiche de l’acteur incarne plutôt la classe ouvrière américaine, l’ ex commando d’élite John Rambo va lui représenter à la fois la mauvaise conscience de l’Amérique comme son anti-communisme le plus outrancier. Retour sur un personnage qui devient un enjeu historique dans les années 80…
Le film "Rambo : First Blood" fondateur de la série, s'inscrit dans la vision désenchantée de l'Amérique suite à la défaite au Vietnam.
Ancien commando d'élite, John Rambo n'a pu se réacclimater à un pays qui n’a rien eu de plus pressé que de vouloir oublier ses vétérans, symbole d’une guerre perdue dont elle ne veut plus parler. Devenu une sorte de vagabond, Rambo subit les vexations du shérif d’une petite bourgade des Rocheuses. Arrêté puis molesté par le policier et ses adjoints, Il finit par exploser, dévaste le commissariat et redevient la bête de guerre qu’il a été. Réfugié dans les montagnes, il est traqué par la garde nationale mais s’avère un gibier plus dangereux que ses chasseurs. Alors que toutes les autorités veulent s’en débarrasser seul le colonel Trautman, son ancien formateur, comprend le traumatisme de l’ancien soldat et tente de calmer le jeu.
Le film est sorti en 82 mais il a été écrit à la fin des années 70. Ronald Reagan vient tout juste d’être élu et le souvenir de la sale guerre est encore vif. Le désenchantement de la décennie précédente est encore palpable dans ce film. La fin originale qui avait même été tournée faisait tuer le personnage dans un dernier baroud inutile contre les forces de l’ordre. Le film sous ses allures de production d’action met le doigt là où ça fait mal. Le retour au pays d’une génération traumatisée par cette guerre perdue et que personne n’attend à la maison.
C’est, malgré la présence de Stallone, un film à relativement petit budget sur lequel peu de gens aurait misé. Il marquera durablement les esprits et s’inscrit parmi les meilleurs films d’action de la décennie 80.
Trois ans plus tard, Rambo revient pour un Rambo II qui part dans une direction diamétralement opposée.
Le vétéran est tiré de la prison où il croupit pour les destructions causées dans le premier opus afin de repartir secrètement au Vietnam vérifier si des prisonniers américains ne s’y trouveraient pas encore détenus. Là, pour sortir ses camarades des prisons où ils croupissent, il se rebelle contre ses commanditaires qui veulent éviter l’incident diplomatique et affronte leurs sadiques geôliers vietnamiens qui sont en plus épaulés par une escouade de spetsnaz, les soldats d’élite soviétiques.
 Barbara et Ronald Reagan au coté de Stallone et de son épouse de l'époque l'actrice Birgit Nielsen
Barbara et Ronald Reagan au coté de Stallone et de son épouse de l'époque l'actrice Birgit NielsenEn 85 l’ambiance n’est plus la même. « America is Back ». Ronald Reagan a relancé la guerre fraîche contre l’empire du mal soviétique. D’ailleurs le président Reagan aurait déclaré après avoir vu le film «Si l’Amérique a un problème, nous saurons qui envoyer… ». L’heure n’est plus à l’apitoiement mais à l’offensive contre l’hydre communiste. Rambo va, court, vole et venge l’Amérique en traversant des rideaux de balles et des bombardements au napalm, regagnant pratiquement la guerre du Vietnam à lui tout seul.
 Le film devient le symbole de la puissance américaine retrouvée. Il relance la vraie question des disparus « missing in action », ces soldats abandonnés sur place aux mains de l’ennemi à la fin de la guerre du Vietnam et qui selon le scénario aurait été volontairement oubliés là bas par des politiciens soucieux de négocier la paix à tout prix. Le film n’est pas très subtil mais diablement efficace. Le personnage devient dans le monde entier le symbole de l’Amérique triomphante et volontaire. Ce n’est pas un hasard si les Guignols de l’info utiliseront la marionnette de Stallone quelques temps plus tard pour symboliser la puissance militaire américaine. Le film n’est pas le seul sur le créneau et toute une série de productions de films de guerre à succès copieront ce modèle alimentant pour les américains le fantasme d’un conflit qui aurait pu être gagné si on y avait mis les moyens…
Le film devient le symbole de la puissance américaine retrouvée. Il relance la vraie question des disparus « missing in action », ces soldats abandonnés sur place aux mains de l’ennemi à la fin de la guerre du Vietnam et qui selon le scénario aurait été volontairement oubliés là bas par des politiciens soucieux de négocier la paix à tout prix. Le film n’est pas très subtil mais diablement efficace. Le personnage devient dans le monde entier le symbole de l’Amérique triomphante et volontaire. Ce n’est pas un hasard si les Guignols de l’info utiliseront la marionnette de Stallone quelques temps plus tard pour symboliser la puissance militaire américaine. Le film n’est pas le seul sur le créneau et toute une série de productions de films de guerre à succès copieront ce modèle alimentant pour les américains le fantasme d’un conflit qui aurait pu être gagné si on y avait mis les moyens…
En 1988, Rambo part cette fois-ci en Afghanistan pour affronter directement les soviétiques qui occupent le pays et délivrer le colonel Trautman retenu prisonnier après une opération ratée d’aide aux maquisards afghans
Prévu pour relancer Stallone dont la carrière commence à s’essouffler, le film joue la carte de la surenchère envoyant Rambo directement face à l’armée rouge. Très manichéen (gentils résistants afghans contre vilains russes tortionnaires), le film dédié au courageux peuple afghan devient risible tant Rambo apparaît ici comme un surhomme invulnérable abattant des hélicoptères à l’arc. Sa sortie, bien que rentable, n’eut pas le succès escompté, en effet l’air du temps a commencé à changer et le film arrive un peu trop tard. Les relations sont devenues beaucoup plus cordiales avec l’arrivée de Mikhaïl Gorbatchev au pouvoir en URSS et l’amélioration des relations américano-soviétique est à l’ordre du jour. Signe des temps une semaine avant la sortie américaine, Gorbatchev annonce le départ des soviétiques d’Afghanistan.
Faute d’ennemi à combattre et suite à la faillite de Carolco, la maison de production possédant les droits du personnage, Rambo s’endort jusqu’en 2008 pour ressortir aujourd’hui dans John Rambo qui nous présente un vétéran vieilli dans un monde qui ne s’est pas calmé avec la chute de l’empire soviétique. Le film, scénarisé et réalisé par Stallone lui-même nous présente donc un Rambo âgé mais toujours massif qui s’est retiré dans la jungle thaïlandaise pour y chercher la paix de l’âme. Un groupe de missionnaires naïfs et légèrement illuminés l’engage pour les mener en Birmanie, en territoire Karen, une ethnie minoritaire qui subit de la part du gouvernement militaire birman un véritable génocide. D’abord réticent à s’impliquer, il reprend les armes lorsque les missionnaires sont enlevés par des militaires birmans lors de l’attaque du village où ils se sont installés.
Soyons honnêtes, le film ne va pas très loin et l’arrière plan birman est surtout un prétexte pour r essusciter un personnage chargé d’un imaginaire encore porteur commercialement après le succès de Rocky Balboa. Rambo ne se bat plus pour l’Amérique, ni pour lui-même mais juste parce qu’il est fait pour cela. Stallone et son visage ravagé par les opérations esthétiques ratées apporte une véritable puissance au film. Mais bon, ce qui reste surtout c’est l’incroyable déchaînement de violence du film qui me font le déconseiller aux plus jeunes et aux plus sensibles. Que ce soient les soudards birmans qui s’amusent à envoyer les civils courir dans les champs de mines ou Rambo lui-même qui arrache des carotides à mains nues, on est abasourdi par la violence des images. Les têtes explosent, les membres sont arrachés sous les impacts, de quoi faire passer le débarquement du « Soldat Ryan » pour « Bambi ». La guerre ce n’est pas beau et le film le montre complaisamment.
essusciter un personnage chargé d’un imaginaire encore porteur commercialement après le succès de Rocky Balboa. Rambo ne se bat plus pour l’Amérique, ni pour lui-même mais juste parce qu’il est fait pour cela. Stallone et son visage ravagé par les opérations esthétiques ratées apporte une véritable puissance au film. Mais bon, ce qui reste surtout c’est l’incroyable déchaînement de violence du film qui me font le déconseiller aux plus jeunes et aux plus sensibles. Que ce soient les soudards birmans qui s’amusent à envoyer les civils courir dans les champs de mines ou Rambo lui-même qui arrache des carotides à mains nues, on est abasourdi par la violence des images. Les têtes explosent, les membres sont arrachés sous les impacts, de quoi faire passer le débarquement du « Soldat Ryan » pour « Bambi ». La guerre ce n’est pas beau et le film le montre complaisamment.
Rambo au final revient dans son pays où il n’est plus ni un rebelle, ni une icône patriotique. Juste quelqu’un qui veut rentrer chez lui. Le ras-le bol de la guerre en Irak est passé par là. Stallone est un républicain mais confesse avoir été très déçu par Bush et son administration. Il appelle à voter John McCain, ancien prisonnier lors de la guerre du Vietnam qui, tout en glorifiant les valeurs traditionnelles américaines et en appelant à poursuivre l'intervention en Irak a été un des premiers à dénoncer les excés de l'administration Bush dans le bourbier irakien. Stallone dans ce film semble déterminé mais aussi plus désabusé : la force a parlé en Irak ou ailleurs. Ce n'était pas une belle chose mais aux yeux de nombreux américains, c'était nécessaire face au terrorisme. Encore une fois Rambo illustre l’état d’esprit de l’Amérique profonde. Il a fallu faire la guerre et cela a été fait. Il est temps de rentrer à la maison maintenant, sans triomphalisme, mais sans honte…